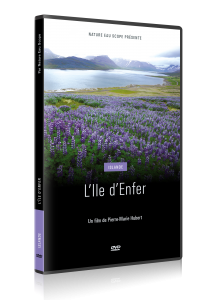A plus de 4 000 m d’altitude, l’Altiplano bolivien et son célèbre lac TICACA ont été le berceau de civilisations pré-colombiennes prestigieuses. La recherche des croyances et des légendes ancestrales nous conduit à découvrir une nature éblouissante, source de divinités, et une population accueillante qui vénère toujours les Dieux de l’Altiplano…
Cinq heures du matin. Nous transportons péniblement nos bagages dans les couloirs encore sombres et silencieux de l’hôtel NAIRA, essoufflés après avoir descendu deux malheureux étages ; la fraîcheur de la rue nous enveloppe et si l’heure est un peu matinale, la rue est étonnamment silencieuse pour une capitale. L’énorme 4×4 rouge et blanc attend là, tapi dans l’ombre, le long du trottoir ; le coffre béant avale sacs, tentes, bidons, nourriture et cartons divers pour un mois d’expédition. Sur la galerie s’entassent 200 litres d’eau, car l’eau dans la région est une source (si j’ose dire !) d’embarras gastriques sérieux pour employer un vocabulaire décent (nous en ferons l’amère expérience). Prennent aussi place sur le toit 400 litres d’essence, les pièces de rechange diverses, amortisseurs, roues de secours, lames de ressort et de quoi (tenter) de réparer un véhicule qui a vu le jour il y a une vingtaine d’années et qui va allègrement sur son dixième tour de la terre par des routes dont je tairai, par respect, l’état. Mario notre chauffeur, brun bien sûr, le teint cuivré et la moustache de Pancho Villa, et qui sera notre compagnon de fortune et d’infortune, ferme le coffre. Il va partager notre aventure pendant tout ce mois de juin et pendant les 6000 kilomètres de notre périple à travers ce pays deux fois grand comme la France, soit environ 1300 kilomètres d’est en ouest et 1500 kilomètres du nord au sud, et peuplé d’à peine huit millions d’habitants, dont 50 à 60 % d’indiens Aymara ou Quechua. Pierre-Marie monte à bord, Bernard, Pauline et moi-même prenons place sur la deuxième banquette. Pauline, la compagne de Bernard qui nous accompagne pendant trois semaines, va faire preuve d’un grand courage, de beaucoup de volonté et aussi d’une imperturbable bonne humeur durant cette période, supportant avec nous l’inquiétude, l’isolement, le froid mordant des hauts plateaux, le tout dans un confort pour le moins précaire, et avec une alimentation aussi « légère que spéciale ». La troisième banquette est encombrée elle, de sacs de nourriture, de riz, pâtes, conserves en tout genre, venus pour partie de France. Et nous nous installons silencieusement, conscients de la portée de cette nouvelle aventure. Nous claquons les portières, le v8 Chevrolet rouge et blanc s’ébroue et vamos, nous quittons à l’aube naissante « calle Sagarnaga » et ses pavés luisants. Nous sommes au fond d’une immense cuvette, à 3632 mètres d’altitude et nous remontons une gigantesque quatre voies, encore peu encombrée et quelques kilomètres plus loin et 400 mètres plus haut, nous quittons La Paz, capitale financière et industrielle d’un pays dont nous allons découvrir l’éblouissante beauté et la révoltante pauvreté. Pendant ce temps, comme vous le savez tous, SUCRE joue le rôle de capitale administrative, du haut de ses cent mille habitants. Pourquoi SUCRE ? C’est simplement le nom du général (Antonio José de Sucre) qui avec Simon BOLIVAR, libérera la Bolivie, (après l’avoir fait pour le Vénézuéla, la Colombie et le Pérou), et en deviendront les premiers présidents. La Bolivie connaîtra donc une histoire mouvementée. Pour preuve, 191 gouvernements se sont succédés à la tête du pays jusqu’à aujourd’hui.
La Paz, un million cinq cent mille habitants regroupés dans cette immense cuvette, à l’abri du terrible climat de l’altiplano, et surveillée par l’Illimani du haut de ses 6402 mètres. Ici, ce sont les gens riches qui habitent dans le fond de la cuvette, à 3600 mètres quand même. Plus vous montez le long des pentes, plus vous êtes pauvres, et plus vous êtes exposés aux rudes vents qui vous guettent, et soumis à 4000 mètres, comme si cela ne suffisait pas, à la pauvreté de l’air ambiant. A La Paz, nombre d’enfants, qui habitent les plus hautes rues du monde, sont abandonnés et survivent de « petits boulots » : cireurs de chaussures, vendeurs de bonbons, ou annonceurs des destination des bus. Nous sommes dans le pays le plus pauvre d’Amérique du sud. 80% de la population vit en deçà du seuil de pauvreté, et une famille d’El Alto gagne en moyenne 30 dollars par mois, soit 10% de ses besoins élémentaires. La Bolivie, puisque c’est de ce pays dont nous parlons, est la république la plus haute et la plus enfermée d’Amérique du sud. C’est dans ce pays que la Cordillère des Andes est la plus large. Et c’est entre la Cordillère Royale et la Cordillère occidentale, sur cet Altiplano qui n’a rien de plat, que va se dérouler notre aventure, à la recherche de croyances ancestrales encore extrêmement vivaces, et au contact d’une population, à peu de chose près vous le lirez bientôt, extrêmement accueillante.
A l’entrée du rigoureux hiver austral, nous descendrons vers le parc Sajama, avec le volcan du même nom, le plus haut de Bolivie (6542 m.). Nous camperons près des sources chaudes de Khala Choco. Nous descendrons ensuite vers le Salar de Coipasa, et l’immense salar d’Uyuni, la plus grande surface plane du globe, immortalisée par les plus grands photographes du monde, et même photographiée de l’espace. Nous tenterons de descendre encore vers l’étonnante Laguna Colorada et ses flamants roses ; pour atteindre ensuite la Laguna Verde, dans cette surprenante région que l’on appelle le Sud Lipez. Mais nous passerons d’abord auprès des geysers de Sol de Mañana à 4850 mètres. Si par chance l’aventure peut se poursuivre, nous traverserons le désert de Siloli et le désert de Dali et ses étranges rochers, pour enfin atteindre le Volcan Licancabur ( 5960 mètres) que nous tenterons de gravir, et qui fait frontière avec le Chili et le désert d’Atacama. Au retour, si nous sommes toujours en vie, nous descendrons rendre visite au Tio, le dieu des mineurs au fond de la mine Rosario, la plus dure des mines d’argent de Potosi, où les mineurs ne survivent que grâce à la feuille de coca, dans des conditions de travail épouvantables. Nous tenterons de regagner quelques degrés de température en remontant vers Cochabamba, le lac Titicaca, Copacabana et Tihuanaco pour les cérémonies du solstice d’hiver.Mais nous n’en sommes pas là. Au sortir de ce trou gigantesque, nous pénétrons dans El Alto, la banlieue misérable et poussiéreuse de La Paz. Les construction d’adobe, la terre locale mélangée de paille, qui mesurent à peine plus de trois mètres sur quatre, et très basses pour nous, peut-être deux mètres, accueillent nombre de familles dans un dénuement presque total. Pourquoi presque total ? parce qu’un peu plus loin, ce ne sont même plus des construction malgré tout en dur qui persistent, mais de simples bâches en plastique, tendues sur une armature en bois, qui servent d’habitation. Le choc avait déjà été rude hier dès la sortie de l’aéroport, dans une clarté et une luminosité d’une exceptionnelle dureté ; mais ces premières heures dans l’hémisphère sud laissent déjà des traces indélébiles. Nous ne sommes pas loin du lac TITICACA, environ une trentaine de kilomètres, mais les évènements que je vais maintenant vous conter, vont bousculer nos plans et nous mettre dans une situation inquiétante, dès les premières heures et les premiers kilomètres de ce voyage.
Et en ce moment, la situation politique, comme nous vous le disions plus haut, n’est pas merveilleuse, et les renseignements pris la veille ne vont en rien nous rassurer. La situation est plutôt explosive, et l’insurrection guette. Dès les premiers kilomètres, les traces des évènements qui déchirent le pays, se dressent devant nous. Des barrages de rochers amoncelés sur la route, tentent d’isoler La Paz de tout trafic. De loin en loin, les nuages noirs des pneus qui brûlent nous annoncent de nouveaux barrages de pierres, et un comité d’accueil, pas très accueillant. La seule portion de route que nous empruntons avant les pistes du chaco, est déjà bien compliquée à gérer. Le soleil se lève à peine en ce mardi 31 mai et déjà les piétons traversent la route à quatre voies sans autre précaution, les innombrables chiens errants font de même, surtout à notre approche ; quand aux cyclistes, ils roulent vers nous, mais sur la même voie ! Alors un obstacle, un barrage de plus ou de moins ! Mais malgré tout, c’est quand même l’angoisse qui domine. Mario sait que nous partons dans des conditions qui vont sérieusement compliquer le voyage. Nous arrivons en sortant de la route, à contourner ainsi une dizaine de barrages. Il n’en est pas de même pour de nombreux poids lourds, pour lesquels sortir de la route est interdit. Quand soudain, au milieu d’un petit village, nous sommes brusquement encerclés par une trentaine de villageois, des « campésinos » dit-on là-bas, armés non seulement d’intentions que nous devinons belliqueuses, mais aussi de bâtons et de barres de fer. Nous sommes promptement entourés et Mario est tiré de force hors du véhicule, pris d’assaut par ces hommes accablés de colère et de pauvreté, et dont le seul défaut est de vouloir partager, un tout petit peu, les richesses du pays. Ils tentent, sans insister plus, d’ouvrir nos portières qui, verrouillées, résistent. Des grappes d’hommes s’accro-chent à la galerie, montent sur le toit, s’agrippent à la roue de secours. Nous sommes « invités » à rejoindre à quelques centaines de mètres, le gros de la troupe, soit environ trois cent personnes, qui nous encerclent immédiatement. S’ils veulent ouvrir les portières, ils vont les ouvrir, c’est sûr. L’angoisse est totale, nous sommes partis depuis trois heures et le voyage est peut-être déjà terminé. Ils peuvent nous dépouiller, détruire la caméra, dans le meilleur des cas, jusqu’à des extrémités que nous n’osons imaginer. Pour le premier voyage de Pauline avec Nature Eau Scope, c’est pour le moins, réussi. Mario part avec un groupe et tente de parlementer ; pendant ce temps, des hommes à la mine patibulaire tournent autour du véhicule, discutent, s’énervent ; certains ont des idées que nous ne souhaitons pas voir mises en œuvre. D’autres, éméchés, titubent déjà. Et l’on connaît les résultats de ces phénomènes que l’on appelle « hystérie collective », et les actes accomplis par des hommes en groupe, dont ils n’auraient, seul, même pas l’idée. Certains ont franchi d’autres limites et sont étendus au sol, totalement ivres, immobiles et en plein soleil. Nous n’osons même pas entrouvrir les glaces pour rafraîchir la voiture, car il règne une chaleur d’étuve dans ce véhicule où nous sommes confinés pour une durée inconnue, mais encore vivant. Il y a trois heures que nous sommes partis !
Mario a disparu, englouti par la foule maintenant presque silencieuse. Des femmes assises dans la poussière, discutent. Les hommes font de même en regardant parfois dans notre direction. Pierre-Marie tente, en espagnol, de leur faire comprendre que nous connaissons leur combat, Simon Bolivar étant venu lui-même en France chercher un « modèle » de révolution. Ces quelques mots vont juste en faire vaciller quelques uns, parmi les moins motivés. 10h00 : Rien n’a bougé, sauf le thermomètre qui monte en même temps que le soleil. Tout reste immobile, sauf quelques lamas qui passent à cinq mètres. 12h30 : Un mouvement se dessine ; nous apercevons Mario, apparemment en bonne santé, se dirigeant vers nous. Ouf, enfin un signe. Lentement, il s’installe au volant du Chevrolet et lance le moteur. Lentement, au ralenti, il s’engage entre les groupes, dont certains sont encore franchement hostiles. Lentement, lentement, nous nous extirpons de la foule exactement comme la voiture de Rock Hudson, de la cour de la maison dans le film « les Oiseaux » d’Alfred Hitchcock. Cette vision me suit encore aujourd’hui. Je n’oublierai jamais, mes compa-gnons non plus, ces heures d’angoisse. Toujours sur les pistes maintenant pour éviter les routes, nous nous prenons à sourire à cette mésaventure, et respirer un peu profondément de soulagement et aussi pour compenser le manque d’air permanent. Les maux de têtes nous assaillent toujours et dureront à peu près une bonne semaine pour tout le monde. Nous saluons Mario, dont les intelligentes tractations, nous ont permis de repartir. Il nous sortira de bien d’autres mauvais pas. Les yeux bleus de Pauline ont retrouvé leur gaîté, et nous autres, les hommes, nous tentons de faire bonne figure. Quelques kilomètres plus loin, nous embarquons un auto-stoppeur ; après tout, montrons-nous courtois et fair-play. Il s’installe sur le toit. Je n’ose avouer qu’en dehors de lui rendre service, il peut nous servir. De passeport, et puis pourquoi pas d’otage lui aussi, de monnaie d’échange, on peut aussi le vendre contre de l’essence, des lamas… Non je plaisante ! Il est bien content d’économiser quelques kilomètres qu’il n’aura pas à faire à pied. Notre passager libéré, nous continuons notre route sous un soleil ardent et un ciel azuréen dirait un écrivain de talent. Mais si je ne suis pas encore celui-ci, cela pourrait venir. Alors dépêchez vous d’acheter, avant que ma cote à la Bourse ne monte très vite, ou que ne je rentre à l’Académie Française ; vous pourrez ainsi spéculer avec mes œuvres dans quelques années. Merci.
Après un repas froid pris aux alentours de 14h00 à l’arrière du véhicule, nous nous dirigeons vers une nouvelle difficulté. Devant nous une rivière, large la rivière, très large, peut-être deux cent mètres. Mais qu’importe, il y a un pont devant. Nous empruntons une rampe de terre qui doit nous élever jusqu’au pont et nous permettre de traverser. Las, en haut de la rampe de terre, le tablier du pont est encore quatre mètres au-dessus de nous. Vous avez essayé vous de monter un 4×4 Chevrolet avec son huit cylindres, son chargement, à quatre mètres au dessus du sol ? Ben nous non plus.
Nous redescendons la rampe en marche arrière pour examiner les environs. Bof, de toute façon, le pont, il s’arrête au milieu de la rivière. Nous envisageons la possibilité de remonter une des deux rives à la recherche d’un autre pont. Mais les ponts ici, ce n’est pas comme les rond-point en France, il n’y en a pas un tous les trente mètres. Mais qu’apercevons nous de l’autre côté ? Des silhouettes qui s’agitent, des gens qui voient le camion, et nous en train de faire des aller et retour à pied. A force de sifflets et de grands gestes, ils finissent par s’installer dans des sortes de barques, et à la force des bras, avec des perches, venir nous rejoindre sur notre rive. Quatre hommes, deux barques, c’est déjà un début. Commencent alors des palabres entre nos visiteurs et Mario. Moyennant une somme fort modeste, ils envisagent, (moi je dirai ils rêvent !), de faire monter le 4×4 sur une des barques, et nous sur l’autre. Sauf que j’ai vraiment l’impression que le camion, il est plus grand que la barque. Non sans une certaine appréhension, le camion s’engage sur la frêle embarcation que nous retenons contre la berge à la force de nos bras. Les roues avant s’engagent, le plat-bord de la barque arrive au ras de l’eau. Pas bon le plan. Mais que ne feraient-ils pas pour gagner quelques sous, quitte à couler notre engin, et notre expédition avec. Lentement (allez je vous refais le coup du film), comme dans le « Salaire de la Peur », centimètre par centimètre, le camion avance vers l’avant, même si j’ai la sensation que les roues avant toucheront la proue, avant que les roues arrières soient embarquées. Nous suivons les évènements dans un silence de mort. Finalement, il est rentré, le camion ; mais lentement l’eau s’infiltre, et va, sans l’ombre d’un doute emplir la barque et envoyer le tout par le fond.
Rapidement, nous tirons à nouveau vers le bord, la barque qui ne s’était éloignée du bord que d’un mètre. Rapidement, tout le monde se met au boulot : il faut décharger le camion. Nous sommes déjà essoufflés avant de commencer, et pourtant il faut vider l’arrière du camion avec les tentes, les sacs de nourriture, le toit avec les bidons de 80 litres d’essence, les packs d’eau, pour soulager le camion d’une demi tonne. Nous terminons exténués. Alors dans un équilibre encore bien fragile à notre goût, l’embarcation s’engage, à la force des bras, contre le courant, dans la traversée des deux cent mètres qui nous séparent de l’autre rive. Montés dans l’autre bateau, nous n’en menons pas large. Galilée avait dit : « et pourtant elle tourne ». Pour parodier cette belle phrase, nous pouvons annoncer : « et pourtant, elle flotte ! » Nous atteindrons l’autre rive sans encombre malgré tout. Recharger le camion nous prendra encore une heure, avant de reprendre la piste poussiéreuse pour éviter de nouveaux barrages, qui nous mènera vers 17h00 au village de CURAHUARA.
Nous arrivons un peu tard, il fait déjà bien sombre, dans la magnifique chapelle du 16ème siècle, faite d’adobe et couverte de chaume. L’intérieur est tellement magnifique de fresques d’animaux, de scènes bibliques, qu’elle est surnommée la « chapelle Sixtine de l’altiplano ». Ce sera une des rares sorties de caméra pour cette journée. Journée tellement éprouvante, que nous nous installons, pour un euro chacun, chez l’habitant pour la nuit. Mario nous trouve deux chambres, celle que je partage avec Pierre-Marie contient deux lits dans une pièce de 2.5 mètres sur 3 mètres. Les matelas sont remplis de paille ; il n’y a pas d’armoire, pas de chaise, pas de lumière, la porte ferme à peine. Comme il gèle déjà, je vous laisse imaginer la suite. Les toilettes sont installées entre trois murs, elles ne sont pas couvertes. Le quatrième pan, ouvert, permet l’installation. Pour indiquer que c’est occupé, une fois installé, vous prenez une demi tôle ondulée que vous placez en travers. La tôle en travers : c’est occupé, pas de tôle : c’est libre, simple ! Il n’y a pas de chasse d’eau non plus, de toute façon l’eau du seau qui remplace la chasse est gelée. Comme la cuvette est uniformément marron – grise, il faudra se retenir.
Une petite pièce avec une table et quatre chaises, nous est attribuée pour dîner. Nous installons le réchaud à alcool pour faire chauffer une soupe, et nous dînons à la lueur blafarde d’une ampoule de 15 watts. Ereintés, soumis aux maux de tête, (le soroche, ou mal des montagnes), nous nous écroulons. Il ne s’est pas passé 24 heures.
06h30. On ne se lève pas trop tôt quand même ! Il a bien gelé cette nuit. Bernard lave les couverts du petit déjeuner, qui gèlent avant que j’aie eu le temps de les essuyer. Quelle vie. Dehors, Mario a préparé le véhicule. Et chaque jour de ce voyage, le camion sera nettoyé à l’intérieur (banquettes et moquettes balayées) et dépoussiéré à l’extérieur. C’est que nous nous sentons bien dans ce camion. Il faut dire que les sièges de velours rouge, ainsi que la moquette de la même couleur, le rendent agréable, même si, bien sûr, il manque quelques accessoires comme le compteur de vitesse, par exemple, et surtout le chauffage. Il nous manquera cruellement bientôt, quand les températures oscilleront vers les moins 15 degrés entre 18h00, dès que le soleil disparaît, jusqu’à 09h00 le lendemain matin. Le problème supplémentaire est que les bouteilles d’eau, celles qui sont à l’intérieur du camion, ne dégèleront plus même pendant la journée. Le soleil sera toujours là, mais le froid aussi. N’oubliez pas qu’en juin nous sommes à la fin du printemps dans l’hémisphère nord, c’est donc le début de l’hiver ici ; CQFD.
C’est encore sur une route nationale (Arica-La Paz), que nous nous dirigeons vers le parc Sajama. C’est sur cette route, que nous franchirons sans encombre l’altitude jamais atteinte pour nous de 4200 mètres. Aujourd’hui, nous roulons sur un ruban presque rectiligne, qui ondule dans la « puna » cette espèce de plaine herbeuse. De nombreux lamas, cousins des chameaux, occupent le terrain, avec en toile de fond le Sajama et son magni-fique dôme de neige et de glace, qui nous toise de ses 6542 mètres. Mais c’est l’eau, qui brusquement apparaît, sous un pont. Vous connaissez mes compagnons, non ? Je vous explique. Eau, cela pourrait rimer avec râteau, bateau, ou radeau. Mais non pas du tout ; ici eau rime avec poisson. Je sais pour la rime, ça ne va pas bien. Mais pour dégainer la gaule plus vite que leur ombre, Bernard et Pierre-Marie, ils en connaissent un rayon. Ce qui fait que vers les 11h00, nous nous retrouvons au bord d’une magnifique rivière, un soleil radieux nous distillant ses bienfaits. Quelques lamas broutent un peu plus loin, et c’est un moment magnifique. Surtout quand les truites se mettent à sortir de l’eau à la vitesse d’une boule de flipper, de l’éclair, d’une rafale de mitraillette. (Choisissez votre version) merci. Elles sont vidées, lavées et mises de côté pour ce soir. Puis, après un peu de repos, souvenez-vous que la journée d’hier fût plutôt mouvementée, et le réveil précoce, nous repartons tranquillement vers le village de Sajama, ses rues attrayantes, bordées d’alojamientos (auberges) bien pittoresques, son parc, son sommet, ses lamas, vigognes et nandous. A l’entrée du village, nous réglons notre écot, et nous aventurons dans ce parc qui est le premier objectif de ce voyage. Le parc Sajama, 80 000 hectares, créé en 1945, devait protéger l’immense volcan Nevado Sajama, et sa faune. Malgré toutes les précautions, le puma a quasi disparu, comme les viscaches, sortes de gros lapins avec les pattes arrières comme les kangourous ; tiens ! On n’en a pas mangé de ceux-là ! Tant pis. Ont aussi disparus les guanacos, et presque disparues aussi, les si jolies et si gracieuses vigognes. Leur laine était si fine, si recherchée, qu’elle était propriété exclusive des empereurs ! Néanmoins il en persiste quelques exemplaires, dont nous aurons la chance de croiser la route. A quelques kilomètres, se trouvent les sources chaudes et les geysers du parc. C’est à cet endroit que nous allons poser le camp. Il fait déjà bien frais. Les trois tentes sont installées près des mares chaudes, dans l’espoir bien vain de profiter de leur chaleur. Nous tenterons même d’utiliser l’une d’elles pour cuire des œufs ; des œufs qui deux heures après, ne seront ni durs, ni même mollets, mais cela fera l’affaire quand même, les truites venant garnir agréablement le repas du soir, pris auprès d’un feu, où nous nous serrons, car le vent vif et glacial, n’encourage pas à jouer les boy-scouts et traîner dehors. Le repas terminé dans le noir, et le feu éteint, nous nous jetons dans les duvets.